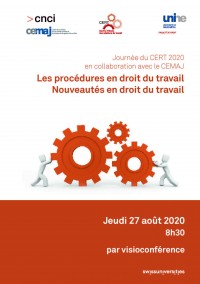TF 2C_70/2019 du 16 septembre 2019
Jours fériés, autorisation de travailler, art. 19 LTr
En application de l’art. 89 al. 2 let. d LTF, combiné avec l’art. 58 LTr, les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont, de par la loi, qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre les décisions des autorités cantonales et fédérales rendues en application de la LTr (rappel de jurisprudence, cons. 1.2).
L’interdiction de travailler les jours fériés, qui avait au départ une justification religieuse, répond désormais également – voire prioritairement – à un but de politique sociale. Au sens de la législation, les jours fériés ne sont pas seulement des jours « analogues » aux dimanches, censés être fêtés, mais bien des jours « identiques » à ceux-ci qui visent aussi à accorder aux travailleurs un temps libre supplémentaire (cons. 3.1).
Les dérogations au principe général de l’interdiction de travailler les dimanches et les jours fériés doivent en toute hypothèse être interprétées restrictivement et non pas extensivement, quand bien même les habitudes des consommateurs auraient subi une certaine évolution depuis l’adoption de la règle. Il n’appartient en effet pas au juge d’interpréter de manière large et contraire à l’esprit de la loi les exceptions au travail dominical, car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l’interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l’art. 18 LTr. La même circonspection doit prévaloir s’agissant des dérogations à l’interdiction de travailler un jour férié (cons. 3.4).
Une ouverture dominicale peut être autorisée notamment lorsque l’on peut constater une étroite corrélation entre, d’une part, l’animation résultant d’un marché de Noël, manifestation d’envergure organisée depuis plusieurs années avec le concours de nombreux commerces locaux et, d’autre part, l’animation due à l’ensemble de l’activité commerciale de la place, qu’il existe une véritable tradition d’ouverture dominicale des commerces liée à cet événement et que la dérogation permet de parer aux effets d’une âpre concurrence étrangère (cons. 3.5).
Il semble arbitraire d’assouplir l’interdiction de travailler un jour férié uniquement parce qu’il tombe sur une journée qui est d’ordinaire ouvrable : la fonction des jours fériés protégés par l’art. 20a LTr est précisément d’offrir la même protection que les dimanches, mais un autre jour de semaine. Si un canton considère qu’il n’est plus nécessaire d’assurer une tranquillité « dominicale » lors de certains jours considérés comme « fériés », il incombe à son législateur – et non au juge – d’intervenir et d’abolir le ou les jours fériés devenus désuets (cons. 3.7).
Le régime restrictif devant prévaloir en matière d’autorisation de travailler les dimanches et les jours fériés en application de l’art. 19 al. 3 LTr n’empêche pas le développement de manifestations culturelles ou sportives, mais uniquement de celles qui présentent un caractère essentiellement commercial (cons. 3.8).
Télécharger en pdf